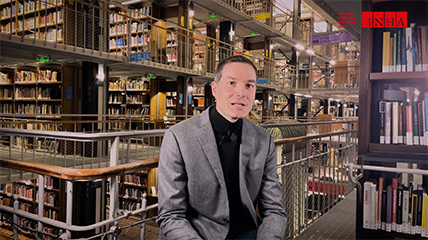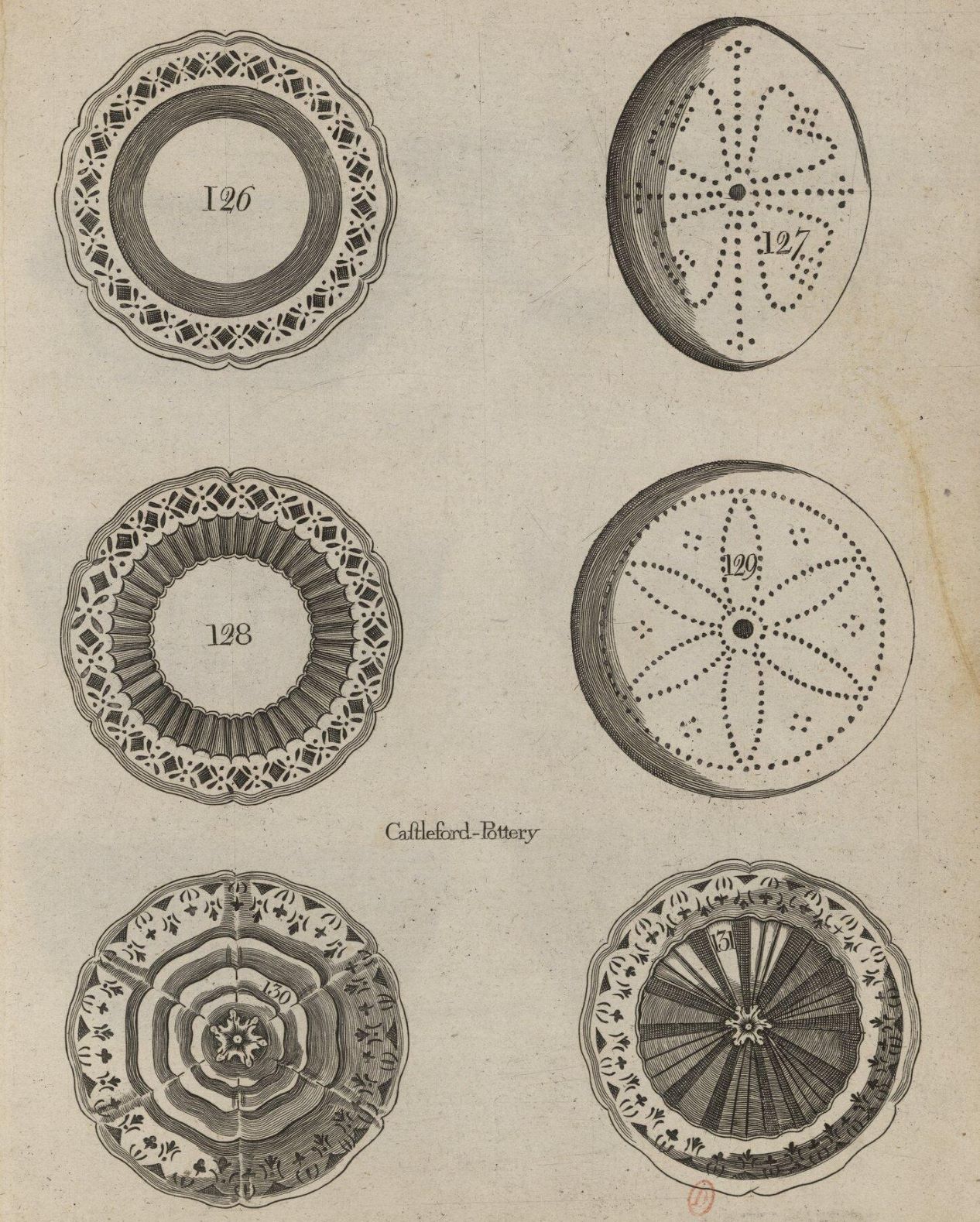Informations sur l’INHA, ses actualités, les domaines et programmes de recherche, l’offre de services et les publications de l’INHA.

Rencontre avec Romain Thomas, conseiller scientifique à l’INHA
Mis à jour le 3 février 2025
Paroles
Romain Thomas, maître de conférences en histoire de l’art moderne à l’université Paris Nanterre, a rejoint le département des études et de la recherche de l’Institut national d’histoire de l’art comme conseiller scientifique pour le domaine Histoire de l’art du XIVe au XIXe siècle en septembre 2023. Il dirige le programme de recherche AORUM (Analyse de l’OR et de ses Usages comme Matériau pictural dans l’Europe occidentale des XVIe et XVIIe siècles), sélectionné par l’ANR en 2022, et qui a reçu également le soutien de la Fondation des Sciences du Patrimoine, de la COMUE Université Paris Lumières, et du programme IPERION-HS.
Vous, en quelques mots ?
Je m’appelle Romain Thomas, je suis historien de l’art et je m’intéresse particulièrement à l’art des Pays-Bas et à la matérialité de l’art. Ces intérêts sont le fruit d’un parcours un peu atypique parce que j’ai commencé par des études de physique et je suis arrivé ensuite à l’histoire et à l’histoire de l’art.
Que faites-vous à l’Institut national d’histoire de l’art ?
Je pilote plusieurs projets. Le projet principal, c’est le programme AORUM qui s’intéresse aux usages de l’or dans la peinture à une époque où les historiens de l’art, en tout cas c’est une hypothèse, ont été aveugles à son usage, après la période médiévale, au XVIe et XVIIe siècles. L’idée est vraiment d’étudier les usages à la fois techniques, iconographiques, symboliques de ce matériau dans un cadre interdisciplinaire. Dans cette perspective, j’encadre toute une équipe avec des mastérants, des doctorants, un pensionnaire et des collègues.
Comment votre sujet de recherche peut-il contribuer à notre compréhension de la société contemporaine ?
On voit aujourd’hui dans les expositions que le public est toujours plus intéressé par ce qui relève de la matérialité de l’art. La matérialité est aussi liée, dans le fond, à ce qu’on pourrait considérer comme des enjeux écologiques, c’est-à-dire nous ramener au monde tel qu’il est, se rendre compte de la beauté des choses telles qu’on les voit, telles qu’on peut quasiment les toucher dans la dimension haptique. Dans le projet AORUM, au-delà d’une approche descriptive de ces techniques, avec mon équipe, j’essaie de m’intéresser à tout ce qui permet d’enrichir la compréhension des œuvres. Par exemple, on pourrait citer aussi la qualité de la lumière ambiante, puisque l’or a une réponse particulière à la lumière par sa brillance.
Un objet, une image, une personnalité qui vous inspire en tant qu’historien de l’art ?
Un historien qui, pour le coup, est mort depuis plusieurs années, qui m’inspire toujours beaucoup, c’est Michael Baxandall, qui a vraiment cherché à s’intéresser à ces approches matérielles de l’art, notamment à travers son livre sur les sculpteurs allemands de la Renaissance. Il a fait une comparaison entre l’art du chiromancien, qui cherche à comprendre ce qu’est, finalement, la personnalité humaine à travers la lecture de la surface, notamment la surface des lignes de la main. Et puis le bois : qu’est-ce que ce matériau, en lisant à la surface du matériau. C’est ça que les sculpteurs allemands, avec le tilleul, devaient faire pour comprendre le matériau: il fallait qu’ils lisent complètement le morceau de bois qu’ils avaient devant eux.
Un souvenir marquant face à l’art ?
Une émotion vraiment esthétique qui m’a saisi à la Galerie Borghèse, il y a quelques années, devant les œuvres sculptées en marbre du Bernin, L’Enlèvement de Proserpine et Apollon et Daphné évidemment, où on peut sentir la matière dans un marbre très dur, mais que l’artiste a ciselé, a sculpté, a transformé véritablement en dentelle.
Voir cet entretien en vidéo
Paroles : rencontre avec Romain Thomas, conseiller scientifique et directeur du programme de recherche AORUM