Informations sur l’INHA, ses actualités, les domaines et programmes de recherche, l’offre de services et les publications de l’INHA.
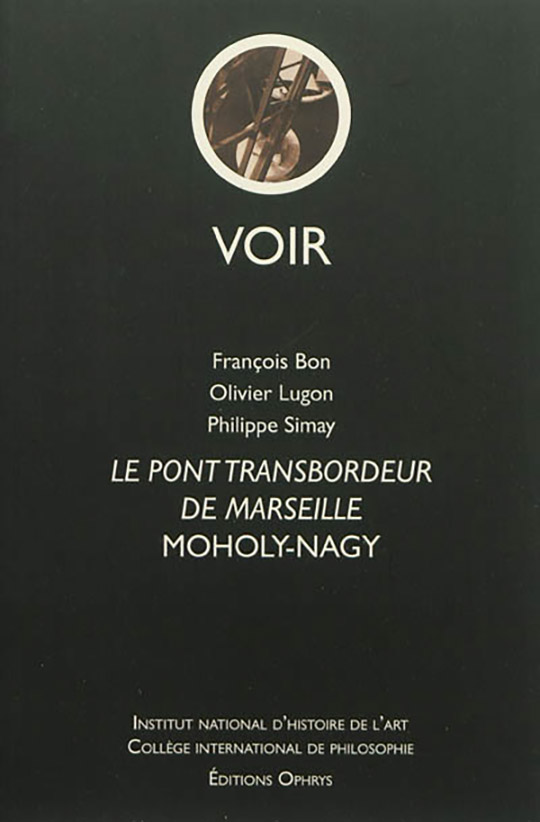
Voir Faire Lire
Entre 1903 et 1905, l’ingénieur et industriel français Ferdinand Arnodin (1845-1924), contemporain de Gustave Eiffel, construit un pont transbordeur au-dessus du Vieux-Port de Marseille (il sera détruit par les Allemands en 1944). Arnodin fut l’inventeur de ce système qui permettait de faire rapidement passer des marchandises d’un quai à l’autre sans avoir à interrompre le trafic maritime : avant celui de Marseille, il avait construit plusieurs ponts transbordeurs, notamment ceux de Rouen, de Bizerte (démonté puis remonté à Brest) et à Nantes. D’une longueur de 239 mètres, le tablier du pont transbordeur de Marseille était tenu par deux pylônes métalliques de 86 mètres de haut : une nacelle de 120 m² y faisait l’aller et retour en moins de deux minutes. Un café restaurant s’y trouvait également.
Cette installation audacieuse, qui modernisait d’un coup le paysage traditionnel du Vieux-Port, suscita évidemment une polémique. Parmi ses admirateurs, on compte, outre Walter Benjamin, le peintre, sculpteur, cinéaste et photographe hongrois Làszlo Moholy-Nagy (1895-1946) qui, en 1929, après son départ du Bauhaus, réalisa une série de photogrammes du pont transbordeur qu’il qualifia de « véritable miracle de la technique, d’une précision et d’une finesse exceptionnelles ».
Trois auteurs – l’écrivain et dramaturge François Bon, le spécialiste de l’histoire de la photographie allemande et américaine de l’entre-deux-guerres Olivier Lugon, professeur à l’université de Lausanne, et le philosophe de l’architecture et de l’urbanisme Philippe Simay, professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne – proposent ici trois approches de l’une des plus célèbres photographies de cette série.