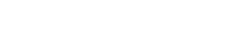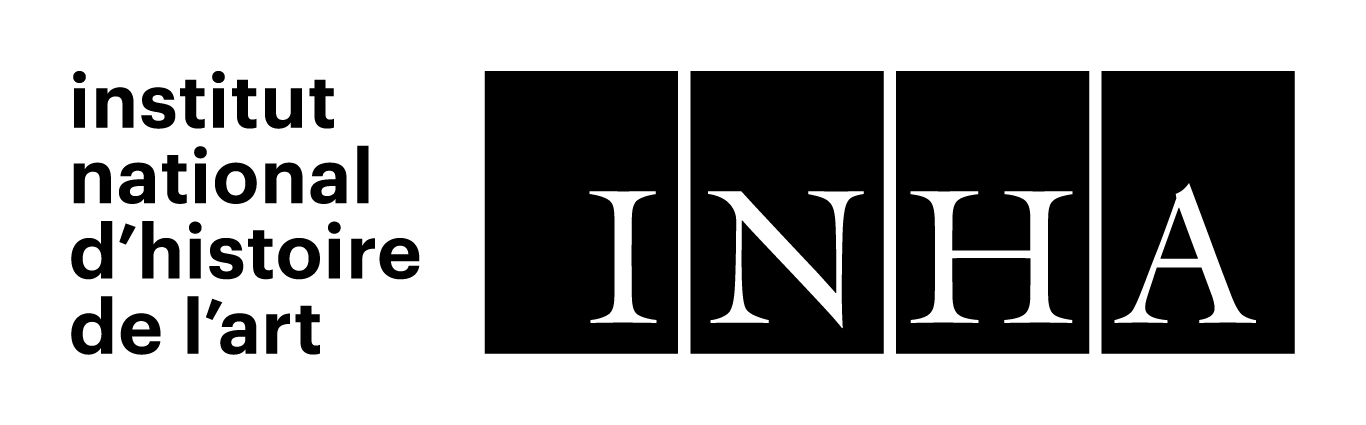- Accès directs
Appel à communication - Provenances archéologiques et marché des antiques à Paris au XIXe siècleEchéance 1er décembre 2022
Appel à contribution
Appel à communication
Provenances archéologiques et marché des antiques à Paris au XIXe siècle
Au sein du marché des antiquités qui s’organise au XIXe siècle en Europe, les objets qui s’échangent sont pour une bonne part issus de fouilles archéologiques, plus ou moins licites, organisées dans des pays et des régions de plus en plus divers. Si cette provenance est parfois mise en avant dans les catalogues de ventes ou dans les appréciations de la valeur des œuvres, cette donnée est majoritairement omise. Elle est aussi parfois erronée, ou imprécise, selon toute une gamme de qualificatifs qui viennent souvent brouiller les circuits empruntés par les œuvres du site de découverte à la vitrine du collectionneur ou du musée. Le Répertoire des ventes d’antiques en France au XIXe siècle (INHA-musée du Louvre) permet de proposer et de traiter de nouvelles données sur ces aspects, en montrant notamment la place de ces mentions dans les sources disponibles. Cette journée cherchera à mieux cerner les multiples enjeux qui entourent ces questions spécifiques au matériel archéologique, qui ont sensiblement évolué tout au long du siècle. On présentera les recherches en cours, aussi bien l’étude de certains sites que des analyses plus transversales. À cette occasion, une nouvelle version du site Sur la piste des œuvres antiques sera présentée, incluant de nouveaux outils d’analyse des données sur les ventes aux enchères (ventedantiques.inha.fr).
***
Une des spécificités des œuvres archéologiques présentes sur le marché de l’art européen est l’existence d’un lieu de découverte. A la différence des autres types de biens échangés, œuvres d’art, livres, etc, ces objets ont été découverts dans un contexte bien particulier, sortis de terre pour suivre ensuite un parcours parfois complexe jusqu’à la salle de vente, la collection ou le musée. Leur enfouissement marque une rupture dans la longue histoire de ces objets, entre le moment de leur enfouissement dans les temps anciens et leur dévoilement à l’époque moderne. Dans le cas des fouilles modernes et scientifiques, le moment de la découverte archéologique est un moment crucial, qui peut apporter beaucoup de données sur le contexte d'utilisation des objets et la société qui les a fabriqués. La fouille scientifique a aujourd’hui acquis une place centrale dans la définition même de la discipline archéologique.
Au XIXe siècle, ces données ont rarement été préservées, d’autant plus concernant les œuvres passant sur le marché de l’art. Une grande partie des objets arrivant à Paris, s’ils ont été fraichement excavés en Italie, en Égypte ou au Levant, de manière plus ou moins légale, n’ont aucune indication de provenance au moment de la vente. Il arrive tout de même que de telles indications soient présentes, avec des degrés de précision très variables : un pays, une région, un site, rarement des indications plus précises de contexte (tombe, monument …). Par ailleurs, la véracité et la fiabilité de ces mentions est également souvent sujette à caution, la véritable provenance pouvant, pour des raisons variées liées aux contextes locaux ou internationaux, être maquillée, soit pour dissimuler une provenance problématique, soit pour au contraire rattacher l’objet à un site prestigieux. Enfin, la mention des sites archéologiques est parfois trompeuse, et ce que nous prenons pour des indications de lieu de découverte peuvent dans l’esprit des contemporains davantage évoquer des styles ou des typologies (comme Vulci, Nola ou Ruvo pour les vases grecs).
Lors de cette journée, nous souhaitons, à la lumière des recherches les plus récentes, remettre en contexte la question de ces provenances archéologiques par rapport à l’époque de leur découverte, le XIXe siècle, et par rapport au marché européen. Plutôt que de faire l’inventaire des manques et pertes, il s’agira d’interroger la place même de ces données pour les acteurs contemporains, avec toute une gamme possible d’attitudes des fouilleurs, marchands, experts, collectionneurs, musées. On s’intéressera aussi aux évolutions sensibles tout au long du siècle, dans la manière d’appréhender ces questions, d’en parler et de les mettre, ou non, en avant.
Les propositions pourront porter aussi bien dans des approches monographiques liées aux sites, aux fouilleurs, experts ou collectionneurs, que des analyses plus synthétiques sur tout ou partie du XIXe siècle. Si le dénominateur commun est le marché parisien, des études sur les œuvres de toutes provenances sont les bienvenues.
La journée d’étude se tiendra le 17 avril 2023, dans la salle Vasari de la galerie Colbert (INHA).
La langue de la journée d'étude et des échanges sera le français, mais les communications en anglais seront acceptées.
Les propositions de communication, accompagnées d’une brève présentation bio-bibliographique, sont à envoyer avant le 1er décembre 2022 à l’adresse suivante : archeologie@inha.fr. (archeologie @ inha.fr)
Comité scientifique
Morgan Belzic (Institut national d’histoire de l’art)
Cécile Colonna (Institut national d’histoire de l’art)
Lucille Garnery (Institut national d’histoire de l’art)
Néguine Mathieux (Musée du Louvre)
Christian Mazet (École française de Rome)
Partenaires
INHA – Institut national d’histoire de l’art
Musée du Louvre